 |
 |
 |
 |


|
|||||||||||||||||||||
A propos de cette œuvreSe souvenir de Georges Perec se souvenant de Jules Verne...Parmi quelques exceptions, dans le cadre des oeuvres n'étant pas une adaptation de Vingt mille lieues sous les mers ou de L'île mystérieuse, mais que nous accueillons tout de même dans notre collection pour y souligner quelques références notables à l'encontre de ces romans, il y a quelques écrits et créations de Georges Perec (1936-1982) que nous voulions évoquer et allons, de fait, très légèrement commenter. Aussi, nous commencerons avec W ou le souvenir d'enfance, ouvrage peut-être le plus vernien de l'écrivain oulipien sur divers points de son élaboration, et qui sert de référence à cet article pour situer celui-ci dans le temps, du moins celui de l'année de la publication du roman aux éditions Denoël (le long-métrage Les Jeux de la comtesse Dolingen de Gratz produit par Georges Perec sous l'influence des vingt mille lieues sous les mers aurait pu convenir tout autant, sinon plus de par son inspiration, mais si W n'est pas aussi marqué par l'odyssée sous-marine, on peut le considérer au centre de l’œuvre perecquienne, cela permettant également d'admirer celle-ci librement avec un large champ de vision, et sans ordre établi). Ce récit – W – que Georges Perec concevra entre 1969 et 1974 fut écrit en partie à la source de certains souvenirs aux contours définis par une mémoire tentant de redessiner le passé au plus près de ce qu'il fut, tout en sachant que même si le souvenir est vivace (ce qui n'est pas exactement le cas pour Georges Perec et une part de sa souvenance), il n'est jamais reproduit en notre esprit comme l'instant qu'il était alors, pouvant être également influencé par des images depuis absorbées, tels les rêves constitués de diverses influences. De plus, les souvenirs de Georges Perec reposent sur une certaine absence de souvenirs ou d'un détachement à leur encontre – Je n'ai pas de souvenirs d'enfance peut-on lire au début de la 1ère partie de W – ceux-ci ayant été affectés à divers degrés par la disparition de ses parents pendant la guerre. La mémoire, personnelle ou encyclopédique, est à ce titre un élément fondamental dans la pensée perecquienne. Deux textes de Georges Perec composent W ou le souvenir d'enfance. Dans le premier, de fiction – voire de ''science fiction'' comme des récits similaires à ceux de Wells ou d'Orwell, écrivains justement évoqués dans W –, l'auteur situe son histoire sur une île à l'extrême sud de l'Amérique. Il y décrit une société totalement isolée du reste du monde, où tout repose sur le sport, et au-delà sur le système des Jeux Olympiques, évoquant au travers de ce lieu celui terrifiant des camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale (en 1941, à 5 ans, Georges Perec est séparé de sa mère qui l'envoie vivre pour sa protection à Villard-de-Lans, avec des membres de la famille de son père. Deux ans plus tard, sa mère est déporté à Auschwitz où elle disparait). Dans le second texte, autobiographique, l'auteur évoque ses souvenirs provenant de l'époque où il vécut une partie de sa jeunesse dans le Vercors après que sa mère l'y ait envoyé. Ainsi, dans cette alternance des deux textes composant l'ouvrage, l'imaginaire se mêle au réel, et vice versa, ou plus exactement encore le texte de fiction – imaginé une première fois par un Georges Perec alors âgé de 13 ans – rejoint le présent, en étant à nouveau imaginé à partir de ses souvenirs (lire notamment les propos de Vincent Bouchot sur les 37 chapitres...). Concernant les récits verniens qui participèrent à la gestation et la construction de W ou le souvenir d'enfance, il y eut la fameuse trilogie composée des romans Les enfants du capitaine Grant (1867), Vingt mille lieues sous les mers (1869) et L'île mystérieuse (1873-1875), le premier ayant été un terreau parmi les références avec lesquelles Georges Perec oeuvra en amont à la création du texte de fiction (Anne Roche soulignera en 1997, dans son étude du roman, des liens également entre celui-ci et L’épave du Cynthia). Le lieu qu'il choisit de mettre en scène dans W fait également référence au roman de Jules Verne Le phare du bout du monde, ce dernier situant son aventure sur une île en Terre de Feu, et de même semble faire le lien entre la cruauté des personnages de l'un et la cruauté d'un système de l'autre. Comme le souligne entre autre Manet van Montfrans, professeur à l'Université d'Amsterdam, dans son excellente étude Georges Perec : la contrainte du réel (1999, rassemblant ou réétudiant diverses analyses), la description de l'île W au chapitre XII prend pour modèle celle que Jules Verne fit pour l'île Lincoln dans le chapitre XI de L'île mystérieuse. Aussi, si dans l’œuvre de Jules Verne, l'île dans son ensemble prenait sur la carte la forme d'un ptéropode (et en diverses parties la mâchoire entrouverte de quelque formidable squale, le crâne aplati d'un fauve, et l’appendice caudal d’un gigantesque alligator), elle prendra pour Georges Perec celle d'un crane de mouton (l'animal figurant peut-être ici l'asservissement). La fondation d'une société en la ''citée idéale'' sur l'île W est de même imaginée. Elle aurait ainsi été créée, selon les légendes, soit par un certain Wilson, personnage faisant référence à Vasquez, le gardien du Phare du bout du monde, soit par le chef d’un groupe de convicts qui se seraient mutinés lors d’un transport en Australie, celui-ci faisant référence au marin Ayrton qui fit acte de mutinerie dans Les enfants du capitaine Grant et que l'on retrouve sur l'île Tabor dans L'île mystérieuse, soit par un certain Nemo ne pouvant plus supporter la société humaine comme le capitaine du Nautilus, ou encore soit par un autre dénommé Wilson, champion ou entraineur, voulant concevoir une nouvelle Olympie protégée en prévision de toutes récupérations idéologiques ou politiques des Jeux. Parmi une riche documentation et une analyse rigoureuse, Manet van Montfrans souligne évidemment que Georges Perec a été fortement marqué par les analogies que l'on peut mettre en relief entre le sport et incidemment les Jeux Olympiques avec un système d'oppression dont l'aboutissement paroxystique est le camp de concentration dixit Perec, ce dernier étant né justement en 1936, date ô combien paroxystique également dans ce contexte avec les 11ème Olympiades se déroulant à Berlin. Dans ce cadre précis, nous ne pouvons que vous conseillez ardemment la lecture du texte de Vincent Bouchot, L'intertextualité vernienne dans ''W ou le souvenir d'enfance'', où il souligne les diverses manifestations verniennes dans l'écriture de Perec – notamment celle des Cinq cents millions de la Bégum – et qui furent et sont encore l'objet de bien d'autres analyses. La Vie mode d'emploi (Hachette, 1978), ultime – dans sa publication – grande oeuvre de Georges Perec conçue entre 1969 et 1978 reprenait, tel le puzzle sur lequel elle reposait, des pièces de la vie et des oeuvres de l'écrivain dont certaines écrites en parrallèle, comme l'intrusion dès les premières pages de son personnage Gaspard Winckler venu de W ou le souvenir d'enfance. On pouvait y lire également un chapitre XVII – Dans l'escalier, 2 – se souvenant de son Je me souviens, découvrir le personnage Grégoire Simpson du chapitre LII – Plassaert, 2 – faisant écho à Un homme qui dort, ou encore parmi tant d'autres pièces, les effets de reproduction d'un tableau et quelques autres détails qu'il reprendra dans Un cabinet d'amateur... Il y joue encore et toujours sur les mots, dans les mots, ou entre les mots, associant même certains qui n'ont pas de rapport apparent entre eux comme lorsqu'il évoque le comédien Stan Laurel par son véritable nom comme compositeur de la rengaine américaine Gertrude of Wyoming composée par Thomas Campbell, et évoquant plus loin encore Stan Laurel par son nom d'artiste... Parmi cet océan de mots dont ceux-ci prennent sens en l'esprit de manière directe, mais aussi tout autant indirectement par les truchements élaborés des découpes de Perec sur son texte puzzle, il y a moult passages évoquant sa passion pour l'oeuvre de Jules Verne. Parmi ceux-ci – outre la phrase d'ouverture du roman reprenant le Regarde de tous tes yeux, regarde issue de Michel Strogoff –, le chapitre VII – Winckler, 1 – de la première partie présente le buffet sculpté par Winckler lui-même sur lequel il avait gravé des illustrations évoquant des scènes de L'île mystérieuse : Il avait une table ronde avec des rallonges qu'il n'avait pas dû utiliser bien souvent, six chaises paillées et un bahut qu'il avait sculpté lui-même et dont les motifs illustraient les scènes capitales de L'Île mystérieuse : la chute du ballon évadé de Richmond, la miraculeuse retrouvaille de Cyrus Smith, l'ultime allumette récupérée dans une poche du gilet de Gédéon Spilett, la découverte de la malle, et jusqu'aux confessions déchirantes d'Ayrton et de Nemo qui concluent ces aventures en les reliant magnifiquement aux Enfants du Capitaine Grant et à Vingt mille lieues sous les mers. […] Valène, était assis à côté du bahut et pendant que la parfumeuse prenait timidement les bagues une à une, il sirotait son cognac en regardant les sculptures ; ce qui l'étonna, avant même qu'il en prenne clairement conscience, c'est qu'il s'attendait à voir des têtes de cerfs, des guirlandes, des feuillages ou des angelots joufflus, alors qu'il était en train de découvrir des petits personnages, la mer, l'horizon, et l'île tout entière, pas encore baptisée Lincoln, telle que les naufragés de l'espace la découvrirent, avec une consternation mêlée de défi, quand ils eurent atteint le plus haut sommet. Il demanda à Winckler si c'était lui qui avait sculpté ce bahut, et Winckler lui répondit que oui, dans sa jeunesse, précisa-t-il, mais sans donner davantage de détails. Au chapitre XV – Chambres de bonne, 5 Smautf – également dans la première partie, le personnage de Mortimer Smautf est comparé à un Passepartout de par les divers services qu'il rend à son maitre Bartlebooth, celui-ci étant de même évoqué tel un Phileas Fogg. Justement, sur quelques vingt années, de 1935 à 1955, ces deux hommes firent le tour du monde. Durant ce périple, Bartlebooth peignit des aquarelles et coucha sur la toile des marines de littoraux réalisées dans les ports qu'il traversait, créant au final 500 oeuvres picturales qu'il fit parvenir au fur et à mesure à Valène (avatar de Perec qui enseigna l'art pictural à Bartlebooth) et à Gaspard Winckler, ce dernier ayant la tache de les transformer en puzzle... Le Chancellor sera également évoqué indirectement dans le chapitre XXIX – Troisième droite, 2 – , avec la présence d'un dessinateur empruntant son nom à celui de l'ingénieur anglais William Falsten du roman de Verne. De même, Winckler fut sélectionné parmi quelques candidats par Bartlebooth en réalisant un puzzle intitulé La dernière Expédition à la Recherche de Franklin dont la tragédie avait en partie inspiré Jules Verne pour Les aventures du capitaine Hatteras. La gouache ayant servi pour ce puzzle fut peinte par l'épouse de Winckler, Marguerite de son prénom (Marguerite Winckler était le nom de l'épouse de Louis Lumière). Perec utilise ainsi tout le long de son récit, ici et là, des descriptions, des références ou encore des noms créés par Jules Verne, tel dans le chapitre XLV – Plassaert, 1 – , l'évocation du missionnaire mormon William Hitch dans le chapitre 27 du Tour du monde en quatre-vingt jours. Dans le chapitre LI – Valène (chambre de bonne, 9) – où le peintre Valène s'imagine se peignant lui-même dans un abyme également proche de celui que l'on trouve dans Un cabinet d'amateur (le tour du monde de Bartlebooth étant de même un exercice englobant moult répétitions dans un unique projet) –, on soulignera parmi les 179 détails énumérés de manière strictement égale dans la forme orthographique et qui apparaitraient sur la toile, trois d'entre eux (ceux-ci étant une partie de la matière du récit de Perec déjà évoqué ou allant l'être) : le détail n°57 avec Orfanik demandant l'air d'Angelica dans l'Orlando d'Arconati, Orfanik étant un personnage du Château des Carpathes ; le détail n°63 revenant sur le drame de l'expédition de Franklin avec Le second du Fox découvrant le dernier message de Fitz-James ; et le 177ème détail exposant L'île mystérieuse avec le journaliste Gédéon Spilett retrouvant dans sa poche une ultime allumette. Parmi les lectures de Cinoc au chapitre LX – Chambres de bonne, 10 –, on peut citer celle d'un Aronnax et au chapitre suivant, on y trouvera un animateur de restaurant boîte de nuit déclamant entre autres du Jules Verne. Encore un peu plus loin, au chapitre LXXII – Caves, 3 –, à propos de l'une des malles qui servit lors du tour du monde de Bartlebooth, on peut lire : La troisième offrait encore tout ce qu'il aurait fallu si, ayant fait naufrage par suite de tempête, typhon, raz-de marée, cyclone ou révolte de l'équipage, Bartlebooth et Smautf avaient eu à dériver sur une épave, aborder sur une île déserte et devoir y survivre. Son contenu reprenait, simplement modernisé, celui de la malle lestée de tonneaux vides que le capitaine Nemo fait échouer sur une plage à l'intention des braves colons de l'île Lincoln, et dont la nomenclature exacte, notée sur une feuille du carnet de Gédéon Spilett, occupe, accompagnée il est vrai de deux gravures presque pleine page, les pages 223 à 226 de L'Île mystérieuse (Éd. Hetzel). Dans le chapitre LXXXIV – Cinoc, 2 –, dans la chambre de Cinoc, parmi les livres exposés, on trouvera le titre ''Sur le clivage pyramidal des albâtres et des gypses'' d'un certain Otto Lidenbrock... et encore dans le chapitre LXXXVIII – Altamont, 5 –, J. T. Maston, personnage de De la Terre à la Lune, devient un peintre d'origine anglaise ayant vécu en Amérique centrale. Bien évidemment, entre autres citations des Raymond, Queneau et Roussel, ce ne sont que quelques exemples verniens facilement exposés dans le texte de Georges Perec, d'autres pouvant être discernables sous divers aspects d'impli-citations... où de manière plus obscur encore, comme cette Île mystérieuse peinte et représentée sur une toile par L. N. Montalescot (nom de référence rousselienne) dans le chapitre LXXXVII – Bartlebooth, 4 –. Jules Verne fut en grande partie présent dans toute l'oeuvre écrite perecquienne. Il en fut de même dans ses ouvrages cinématographiques, et parmi ceux-ci dans le film qu'il produisit – en créant Les Films du Nautile – Les Jeux de la comtesse Dolingen de Gratz, long-métrage réalisé en 1980-81 par Catherine Binet (1944-2006), sa compagne. Dans cet oeuvre qui s'inspire du roman autobiographique Sombre printemps (Ed. Le Serpent à Plumes) de Unica Zürn (où l'auteure, victime d'inceste dans son enfance, se raconte), avec un emprunt au premier chapitre de Dracula de Bram Stoker, il est fait une longue évocation de Vingt mille lieues sous les mers. Celle-ci prend place alors que Louise, la jeune femme interprétée par Carol Kane, protagoniste dont l'époux est interprété par Michael Lonsdale, replonge dans un volume de ce Voyage extraordinaire où les souvenirs l'a mènent à la jeune adolescente (interprétée par Katia Wastchenko) imaginée par une amie dans un roman autobiographique, jeune fille ayant souffert de son entourage familier comme Unica Zürn, et comme souffre son amie à qui elle rend visite dans un hôpital psychiatrique et qui finira par se suicider, toute comme Louise dont les rapports avec son mari sont proches d'une certaine aliénation de la part de celui-ci. La jeune fille mêlait ainsi ses effrois à certaines visions de l'aventure vernienne. Si ses peurs se liaient notamment aux apparitions des scaphandriers et autres manifestations de créatures aquatiques, la présence du capitaine Nemo l'a rassurait néanmoins. Pendant cette séquence de quelques minutes où la voix de la jeune fille expose ses pensées et où une certaine souffrance tendra à se faire de plus en plus étouffante – jusqu'à son suicide –, de nombreuses gravures de Neuville et Riou issues du roman de Jules Verne sont exposées à l'écran résumant par leur nombre une grande part du récit vernien. Ce souvenir est particulièrement lié à celui de son frère – séquence suivante – qui lui a imposé des relations incestueuses, ce sera le cas également de sa mère (interprétée par Marina Vlady). Tout comme dans le roman, la jeune fille portera un certain sentiment amoureux pour le capitaine Nemo, sentiment qu'elle transportera et nourrira à l'égard d'un homme aperçu à la piscine, élément évidemment liquide que l'on peut associer à l'univers océanique du capitaine. Elle lui rendra même visite chez lui alors qu'il est alité tel le Nemo de L'île mystérieuse... C'est le plasticien Roberto Platé qui interprète ce personnage, tout en œuvrant sur les décors du film, et jouant également deux autres rôles, l'un lié à Louise avec la première scène du film où cette dernière, dans un train, rencontre trois argentins dont il fait parti ; l'autre lié à son époux en tant que voleur, pénétrant dans la propriété où le mari de Louise se retire du monde, en solitaire, jouissant de ses biens qui l'entoure... La scène où il installe des barreaux autour de la cheminée, provocant l'état de prisonnier de son voleur qui, seul, mourra de faim, est marquante à plus d'un titre, puisque toute cette oeuvre est ainsi bâtie sur des petites prisons, elles-mêmes construites autour de leurs occupants qui ne pourront éviter la mort pour s'en délivrer. Une autre évocation de Vingt mille lieues sous les mers concerne l'époux interprété par Michael Lonsdale, collectionneur quasi maniaque d'anges anciens. Aussi comme Vincent Bouchot le souligne dans ses travaux, le nom de ce personnage, Haines-Pearson, fait écho à celui de Nemo, et l'on pourra voir à cet effet dans une scène, Michael Lonsdale feuilleté un volume de Vingt mille lieues sous les mers, la séquence étant illustrée avec des gravures originales du roman montrant toutes le capitaine du Nautilus. Si Georges Perec vit le film projeté et en compétition en 1981 à la Mostra de Venise, il mourra le 3 mars 1982, peu avant sa sortie nationale le 24 mars. Bien que ceci soit sans rapport, cela peut faire légèrement écho à l'un de ses souvenirs qu'il avait énuméré dans Je me souviens, quand il dit se souvenir de la mort de Boris Vian, celle-ci étant intervenue alors qu'il assistait à la projection d'un long-métrage qui venait juste de sortir sur grand écran et qui adaptait l'un de ses textes les plus célèbres, J'irai cracher sur vos tombes. Il ne vit que le début du film, la mort l'emportant bien avant la fin de la séance, lui évitant ainsi de voir une oeuvre cinématographique qu'il n'approuvait pas de par certains choix des producteurs. Toutefois, Georges Perec avait préalablement connu à quelques reprises la satisfaction de transmettre par l'image ses écrits, et ce avec une liberté certaine. A ce propos, on peut justement se rappeler dans Je me souviens (Hachette, 1978) que l'une des souvenances évoquées fait mention du comédien comique mexicain Catinflas dans le rôle de Passepartout dans l'adaptation cinématographique du Tour du monde en 80 jours réalisée en 1956 par Michael Anderson ; film avec entre autre Martine Carol et Shirley MacLaine qui faisaient également parti des souvenirs égrenés par Georges Perec, nombre de ceux-ci puisant leur réminiscence dans le cinéma. A cet égard, dans le contexte de la scène et de l'image, et dans une excellence de l'interprétation, Sami Frey exposa sur les planches cet ouvrage de Georges Perec. Pédalant sur une bicyclette tout le long de la pièce mise sobrement en scène, le texte étant une longue liste de souvenirs – 479 pour être précis – se suivant dans un ordre semblant non établi, l'acteur récitait à la fois sobrement le défilé de souvenances éparses tout en lui insufflant un certain rythme imposé par ses poussées sur le pédalier. Le choix de s'accompagner de ce moyen de locomotion pour faire sonner les mots de l'écrivain provient en partie de la présence des cyclistes évoqués dans les souvenirs de Georges Perec, et pour cause celui-ci aimait à suivre les exploits de ces personnalités du sport. D'ailleurs le décors de la scène rappelle quelques paysages ''enfantin'' pouvant évoquer notamment monts et cols d'un Tour de France, où d'autres paysages pouvant être de ceux observés pendant l'adolescence de l'écrivain... Dans La vie mode d'emploi (dans le chapitre LXXIII consacré au bourrelier Massy, figure fictive du cyclisme), il écrira quelques mots sur le Tour d'Italie de 1924 et celui de France le succédant, citant des héros de la petit reine comme Giuseppe Enrici, Ottavio Bottecchia, ou l'impressionnant Alfredo Binda... (voir également une référence au Tour de France de 1975 dans le chapitre LXXXV). De plus, Georges Perec écrivant toujours sous une certaine contrainte bien établie, Sami Frey en fit ainsi autant en choisissant de réciter son texte tout en pédalant, mais espace scénique oblige, en faisant du surplace, la bicyclette étant disposée sur un système la retenant mais lui permettant tout de même d'osciller quelques mouvements. Les souvenirs évoqués en une longue liste étaient en quelque sorte comme une rengaine dont seul l'esprit pouvait s'épuiser à se remémorer un fait dans l'espace de la mémoire, tout comme le cycliste s'épuise à pédaler, et de surcroit le comédien le faisant ici sans produire la moindre avancée à sa bicyclette, comme une sorte de mouvement perpétuel... tel le cycliste engrangeant les kilomètres, la mémoire au fil du temps engrangeant les souvenirs, prenant de multiples chemins dans l'encéphale, comme un réseau sur une carte de géographie... les souvenirs qui renvoient comme aux diverses descriptions de la Vie mode d'emploi au temps qui passe, et aux vies qui trépassent... On peut également citer Un homme qui dort (Denoël, 1969) – dont la lecture est une extase tout autant que celle matérielle que Jean-Marie Gustave Le Clézio écrivit la même année – qui au travers de sa transcription au cinéma en 1974 mis en scène par Bernard Queysanne, dont on ressent dans la réalisation l'écoulement du temps adopté pour le documentaire, émet quelques références à Jules Verne. Ainsi, on peut y apercevoir un volume de L'île mystérieuse couché sur une étagère de la chambre occupée par l'homme qui dort (dans le roman, l'homme retrouvera les volumes de Jules Verne de son enfance, avec ceux d'Alexandre Dumas et de Jack London, en passant quelque temps chez ses parents, visite qui n'est pas mise en scène dans le film), un plan sur un escalier en colimaçon tel celui de la maison de Jules Verne à Amiens (spirale hélicoïdale) faisant penser au Nautile (spirale logarithmique), et cet homme qui se perd dans la torpeur de son existence inexistante, s'extrayant peu à peu hors du flot de la vie, et qui surtout dans cette perdition semble quitter le monde tel le capitaine Nemo, sans toutefois trouver un refuge comme dans le Nautilus... Le capitaine justement – et plus particulièrement la bibliothèque occupant le salon de son sous-marin – est aussi évoqué par Georges Perec dans Penser/classer, dans le chapitre intitulé Notes brèves sur l'art et la manière de ranger ses livres (texte publié trois ans après la mort de Georges Perec) ou encore dans Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? Un cabinet d'amateur (Balland, 1979), nouvelle conçue avec une certaine filiation à La vie mode d'emploi, fera mention, dans la multitude de références imaginaires énoncées avec cette maitrise toute oulipienne de Perec, à un certain Eugène Riou ayant peint une toile du Voyage au centre de la Terre. Ce texte de par son sujet, ou plutôt de par son cadre, avait quelque chose du portrait de Dorian Gray dans les sentiments que l'on pouvait avoir du tableau au centre de cette histoire dont la postface était extraite de Vingt mille lieues sous les mers, alors que le professeur Aronnax observe les tableaux exposés dans le salon du capitaine Nemo. Georges Perec évoquera également à de multiples reprises Jules Verne lors d'interviews ou de nombreux entretiens qu'il donnera notamment au travers du petit écran. Ainsi, si Jules Verne fit voyager ses lecteurs de par les géographies qu'il dessinait au travers de ses récits, Georges Perec fut lui, le géographe même de sa propre écriture et de son univers, dessinant ses cartes à partir de divers Atlas, celui tout d'abord de sa mémoire, tout en empruntant, selon sa perspective, parmi les plus hauts reliefs de la littérature, dont ceux des Voyages extraordinaires, offrant ainsi un siècle plus tard une autre oeuvre tout aussi en dehors de l'ordinaire... De la Vie mode d'emploi, à Mobilis in Mobile... Le projet de concevoir un ouvrage aussi phénoménal et imposant que La Vie mode d'emploi est comme l'un des personnages central de l'oeuvre – Bartlebooth – qui s'impose à lui-même, à l'image de toutes les contraintes auxquelles l'écrivain soumettait ses textes, un projet d'ordre contraignant : Imaginons un homme dont la fortune n'aurait d'égale que l'indifférence à ce que la fortune permet généralement, et dont le désir serait, beaucoup plus orgueilleusement, de saisir, de décrire, d'épuiser, non la totalité du monde – projet que son seul énoncé suffit à ruiner – mais un fragment constitué de celui-ci : face à l'inextricable incohérence du monde, il s'agira alors d'accomplir jusqu'au bout un programme, restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible. Bartlebooth, en d'autres termes, décida un jour que sa vie tout entière serait organisée autour d'un projet unique dont la nécessité arbitraire n'aurait d'autre fin qu'elle-même. Cette idée lui vint alors qu'il avait vingt ans. Ce fut d'abord une idée vague, une question qui se posait – que faire ? –, une réponse qui s'esquissait : rien. L'argent, le pouvoir, l'art, les femmes, n'intéressaient pas Bartlebooth. Ni la science, ni même le jeu. Tout au plus les cravates et les chevaux ou, si l'on préfère, imprécise mais palpitante sous ces illustrations futiles (encore que des milliers de personnes ordonnent efficacement leur vie autour de leurs cravates et un nombre bien plus grand encore autour de leurs chevaux du dimanche), une certaine idée de la perfection. Sans aller dans le sens strict de cette idée, le site ''Mobilis in Mobile, le mythe du Nautilus et du capitaine Nemo'', et surtout sans prétendre quoi que ce soit, s'efforce en quelque sorte d'effleurer dans sa démarche cette certaine idée de la perfection ; non pas que son contenu soit d'une extrême perfectibilité, ni même que nous désirions faire disparaître celui-ci après que nous nous en soyons le plus rapproché – encore faudrait-il avoir conscience d'avoir atteint un quelconque but – , loin de là cette idée. Mais justement, pour reprendre les mots de Georges Perec, notre intention est tout simplement d'accomplir jusqu'au bout – du moins dans l'instant de cette formulation – un programme, restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible, et c'est en ce sens ce que nous tenterons, encore et encore, de mettre en lumière les oeuvres ayant mis en forme le capitaine Nemo et son Nautilus, où s'en étant directement inspirées. Jacques Romero, 11/2011 Galerie : images issues du film Les Jeux de la comtesse Dolingen de Gratz. Galerie 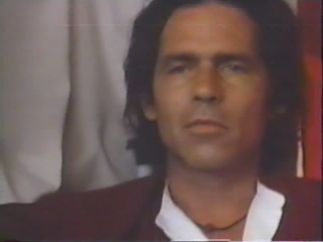      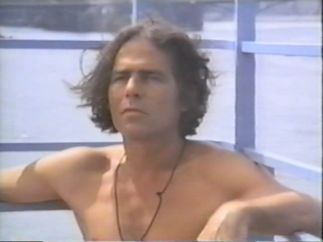  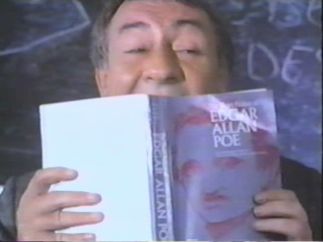     
|
|||||||||||||||||||||


|
|||||||||||||||||||||